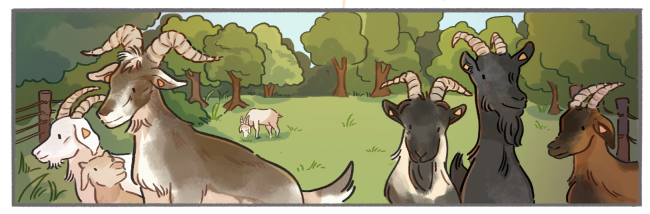Géraldine Jourdan

Fiche d'identité
Borlon
Belgique
1
: 18ha en prairies permanentes, dont 2,5 en propriété
Elevage caprin bio avec transformation fromagère et ventre directe
Table des matières
Content toc
Une agroécologie impliquée et appliquée
« Un vieil oncle de mon papa avait une chèvre dans son salon à Anlier, qu’il nourrissait au Nic-Nac. » Depuis lors, Géraldine rêve de devenir chevrière. J’ai tanné mes parents dès l’âge de 8 ans pour avoir une chèvre, déclare-t-elle.
Avant que son rêve ne se concrétise, Géraldine réalise des études en chimie et obtient un master. Elle voyage ensuite un long moment à l’étranger. C’est en 2007, alors âgée d’une trentaine d’années, que Géraldine s’installe à Borlon avec son compagnon, leurs trois enfants et... deux chèvres. Cette nouvelle vie de sédentaire lui offre l’occasion de démarrer un nouveau projet. Petit à petit, en gardant ses chevrettes, son cheptel s’est agrandi. Parallèlement, cette « maman au jardin », comme elle le précise avec insistance, s’occupe de leurs trois jeunes garçons.
L’environnement dans lequel Géraldine a grandi ainsi que son installation progressive lui ont permis “d’apprendre les précieux gestes paysans” tels que la naissance des chevreaux, la traite, la transformation du lait cru, ... Géraldine possède plusieurs casquettes : éleveuse, productrice, vendeuse et transmettrice de savoirs. Son métier multifacette lui permet de ne jamais s’ennuyer et d’accéder à une grande autonomie. A la question de savoir comment la transition prend forme dans sa ferme, Géraldine répond :
Je suis née dans la transition il y a quasiment un demi-siècle. J’en ai marre d’être dans la transition, mes parents y étaient déjà. Je voudrais passer à l’étape suivante : ne parlons plus de transition, parlons de « on y est » ! La transition ne prend pas forme pour moi : elle est au quotidien.
La chevrière met peu à peu en place un système résilient traduisant ses valeurs et concrétisant ses savoirs et savoir-faire. Elle a ainsi façonné son système comme elle les voulait, alliant monotraite, vente directe, transmissions des savoirs et éco-pâturage, lui permettant d’élever tous ses chevreaux de l’année, mâles ou femelles.
Traduire ses valeurs en actes au quotidien
Une agroécologie ancrée au côté du vivant
Pour moi, la durabilité, c’est poser des gestes qui ne laissent pas de traces, ou seulement de belles traces. On passe mais on ne perturbe rien. Ce qui compte pour moi, c’est de faire partie d’un tout, d’un ensemble le plus équilibré possible. Je fais partie d’un écosystème et j’essaie qu’il soit le plus complet possible. Chaque année, je veux ajouter quelque chose. Au début, tu ne vois pas trop vers quoi tu vas mais quand tu le fais depuis 15 ans, ça commence à porter ses fruits.
Pour Géraldine, l’agroécologie et la durabilité sont en marche, elles s’exercent. L’agriculture biologique n’est pas l’opposé mais la base, le cœur du métier d’éleveur. Elle insiste sur la cohérence d’un ensemble nourricier inscrit dans un milieu sans que l’humain ne se place au-dessus.
Ce qui compte aussi c’est faire plaisir à tous, aux animaux, aux clients et avoir du plaisir à le faire. Chaque maillon compte et est à respecter. Les pratiques agroécologiques peuvent améliorer même si, en fait, la nature sait très bien faire sans nous mais nos actes ne peuvent plus abîmer. On fait partie d’un tout. On n’est pas au-dessus de la pyramide.
Observer, respirer, décider et ne pas paniquer, ne pas agir précipitamment sur la seule base de repères chiffrés, de seuils d’intervention parfois trop bas qui incitent à l’usage de traitements. Telles sont les étapes décrites par Géraldine lorsqu’elle est confrontée à un problème. Son mantra : il faut faire confiance, la nature change et on doit changer avec elle. Curieuse, Géraldine lit, s’informe et se forme sur des pratiques alternatives : plessage, aromathérapie, ...
Je fais le choix de soigner mes chèvres en aromathérapie avec des points d’acupuncture précis et quand ça ne marche pas évidemment je ne laisse pas crever l’animal : je fais tout (pour le soigner). Je contribue à la production de données et de références sur l’élevage de chèvres en contexte wallon et bénéficie de formations.
Faire confiance à la nature ! Pour Géraldine, il ne s’agit pas d’une croyance mais de constats qui reposent sur une observation longue des cycles et des interactions entre les acteurs du milieu. Il s’agit de s’inspirer de ce que la nature montre pour pouvoir faire autrement sans nécessairement se baser sur des normes, des habitudes, des standards. Dans l'élevage par exemple, la croissance du chevreau, on va te les peser tous les deux trois jours pour voir qu'ils grandissent bien. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a toute la transmission mère-jeune. Parce que sinon, la prise de poids, c'est un peu comme le rendement hectare pour moi, tu ne te focalises que là-dessus, on oublie toute l'énergie grise.
Voilà, ce n’est pas grand, c’est suffisant !
Afin de garder cette dimension durable, Géraldine a choisi de ne pas inscrire son travail dans la maximisation mais dans la modestie. Les installations, les réflexions, la pratique reflètent cette maitrise de l’échelle de production afin de s’ancrer de façon cohérente dans l’agroécosystème local de Borlon. Géraldine maitrise aussi le nombre de chèvres en cohérence avec la disponibilité en fourrages et la quantité de lait nécessaire pour produire des fromages. Tout ceci lui permet de répondre à la demande des clients, sans surplus.
Cette posture s’inscrit aussi dans une conception étape par étape de la mise en place du système. Pour Géraldine, il importe de commencer petit, de rester à une petite échelle gérable en autonomie et d’ajouter peu à peu de la complémentarité. Avec le temps, elle a pu déployer des nouveaux circuits de distribution, enrichir la gamme des produits fabriqués de ses mains, développer l’éco-pâturage, … Ce pas à pas chemine dans les limites du faisable cadré par ses valeurs.
Parmi les valeurs qui lui sont chères figure la volonté d’élever ses chevreaux, femelles et mâles. Géraldine a, au fil des années, mis en place un système qui rendait cet élevage possible. A la naissance, les chevreaux sont laissés avec leur mère. La période des naissances est une période charnière, toute l’attention est portée sur la bonne santé des chèvres et le “bon démarrage” des chevreaux. Cette organisation permet à Géraldine de ne pas ajouter l’astreinte quotidienne de la traite durant cette période de soin intense. Ce sont les chevreaux qui se régalent du lait durant leur premier mois de vie. Ensuite, chaque soir, les mères sont séparées des petits qui passent la nuit dans la « baby box », un espace de la chèvrerie conçu pour eux. Cette séparation permet aux mères de conserver leur lait produit la nuit, lait qui est collecté le matin lors de la traite. Les petits retrouvent ensuite leur mère pour la journée. Enfin vers l’âge de 3 mois, le sevrage a lieu. C’est grâce au soutien de Natagora que Géraldine peut mettre l’ensemble des chevreaux en éco-pâturage dans des réserves naturelles.
Je ne voulais pas endetter la famille, je veux être libre d’arrêter à tout instant, et donc ne pas être tenue par le remboursement d’un crédit supplémentaire.
Ce système complexe et complet permet, au niveau économique, de générer un bénéfice. Bénéfice qu’elle investit en « bonne maman de famille » dans son outil de travail. Car Géraldine y tient : elle refuse d’emprunter, répondant ainsi à son objectif de pouvoir arrêter son activité en cas de pépin, et de garder sa famille en sécurité. Car si l’activité est à l’équilibre, elle ne permet pas à elle seule de faire vivre sa famille.
L’objectif de l’éleveuse n’est pas de faire du chiffre. Géraldine déclare ne pas avoir d’intérêt pour un gain de volume mais pour la qualité : celle de la transformation fromagère, celle du bien-être de ses animaux, celle de ses liens aux clients et aux multiples partenaires.
Ainsi, parce qu’elle ne veut pas dépendre de firmes internationales et des banques, parce qu’elle veut limiter son empreinte environnementale et sa dépendance aux fournisseurs, elle a fait le choix de limiter son équipement et de suivre des voies alternatives. La chèvrerie est en auto-construction et la fromagerie est chauffée par une chaudière au bois. Le lait encore chaud de la traite est directement transformé, évitant ainsi de devoir le refroidir et de le réchauffer avant de le travailler. Il n’y pas de chambre froide : le fromage du jour est vendu en tant que frais ou affiné dans les jours qui suivent. Elle déploie également des pratiques complémentaires qui nourrissent tant son autonomie que ses animaux. Elle fait, par exemple, germer les céréales qu’elle donne aux chèvres.
Cette non-dépendance aux banques permet aussi à l’éleveuse d’ancrer son projet dans son désir d’autonomie maximale. Pour Géraldine, il importe de tout faire de A à Z même si au départ je voyais la production fromagère comme le mal nécessaire pour pouvoir élever des chèvres.
Vraiment chaque gramme de caillé est précieux. Il faut savoir qu'il faut déjà deux ans pour avoir la première goutte de lait d'une chèvre. Alors si en plus j'en perds en chemin, …
Le recyclage et le bouclage des flux sont également un moteur de l’autonomie. Je ne jette rien : rien ne se perd, tout se transforme. Les vieilles étamines finissent leur carrière en morceaux, pour l’égouttage des boules de fromages à l’ail et fines herbes. Le petit lait, résidu de la transformation fromagère, nourrit deux cochons. Le moindre gramme de caillé est travaillé et valorisé en Bicochet, de petites boules de fromage.
Un fromage au goût de lien social
Le bon équilibre du projet de Géraldine dépend de la vente de ses fromages. Pourtant elle affirme que les marchés et les chèvres sont deux mondes distincts. Elle s’explique : les chèvres nécessitent de la flexibilité. A contrario, la présence sur les marchés demande d’être ponctuelle. En vendant ses produits elle-même, Géraldine répond à une attente de sa clientèle. Sa présence est donc nécessaire sur le marché le soir, ce qui a nécessité de passer en monotraite. Géraldine fait d’une contrainte un atout pour le bien-être de ses mangeurs et de ses animaux.
Alors, comment ça va aujourd’hui ? Et les enfants ? Et vos vacances ? Entre le grand tissu qu’elle a brodé aux couleurs de la ferme et le comptoir-remorque qu’elle a construit, Géraldine s’enquiert de l’état d’esprit de chacun de ses clients même si ces derniers ne s’imaginent même pas que je peux aussi ne pas avoir le moral. Ils lui font part de leur tracas et petits bonheurs. Certains partagent avec elle sur les réseau sociaux les recettes avec son pélardong ou sa feta. D’autres lui envoient des photos de « leurs infidélités » lorsqu’ils consomment du fromage de chèvre en vacances ou lui communiquent les commentaires de leurs hôtes auxquels ils offrent le fromage de la chèvrerie de Borlon.
Ces échanges sont synonymes et indicatifs, selon Géraldine, de la confiance et de la fidélité de ses clients qui reviennent régulièrement acheter ses produits sur le marché, à la ferme, en épicerie ou au restaurant. Il faut donc se bouger pour vendre ! Être présent en personne in situ mais aussi virtuellement pour informer de ce qui se passe à la chèvrerie, des nouveautés testées ou encore du prochain retour de la mozzarella. Elle « bichonne » ses mangeurs car tu mets du temps à les gagner, tu peux très vite les perdre.
Un fromage incarné
La vente directe est également l’occasion pour Géraldine de transmettre aux acheteurs ses connaissances et la logique de la fabrique qui aboutit au fromage présenté sur le comptoir. C’est essentiel de faire preuve d’éducation permanente avec un public de tout âge pour la chevrière.
Pour ce faire, elle peut compter sur « le capital sympathie énorme des chèvres » qui lui permet de « communiquer, militer, partager ». La saisonnalité, le respect des cycles naturels importent à la chevrière et elle veille à transmettre ses valeurs incarnées par un « bon et beau » fromage qui sera dégusté. Cette transmission des savoirs à ses clients s’inscrit dans une dimension plus large, nous y reviendrons.
L’imagination et l’humour de Géraldine se retrouvent dans l’invention des mots, dans certaines expressions mais également dans les noms de ses fromages. Avec humour, elle détourne des noms bien connus pour souligner une caractéristique de son produit par contraste ou similitude (Camemborl, Mozzarella di biquetta, les Bik’Agés…).
La communication de l’éleveuse sur les réseaux sociaux et sur le marché témoigne de sa créativité. Ses mots sont descriptifs et rendent compte des pratiques et des postures explorant autrement le monde : à travers ses récits de la vie quotidienne des chèvres et de leurs petits, à travers son comptoir sur lequel elle a noté à la craie, à destination de ses clients « tous les êtres vivants de la chèvrerie vous remercie ».
La créativité, entre magie et chimie
L’incarnation de la chimiste dans ses fromages se retrouve aussi lorsqu’elle conjugue « magie et chimie ». Géraldine explique s’être orientée vers la chimie car pour moi, la chimie, c’est de la magie, raconte-t-elle. Elle peut ainsi mobiliser ses connaissances scientifiques pour appréhender les processus dans la fabrication du fromage. Le kéfir en constitue un excellent exemple.
Tous les jours, je l’égoutte et je prends du lait kéfiré. Je reprends du nouveau lait que je refais kéfirer pour le lendemain et j’ensemence mon lait. Si un chevreau ou un veau n’aurait pas eu assez de colostrum, on peut lui administrer du lait kéfiré pour l’ensemencer et qu’il puisse démarrer. C’est quelque chose d’assez magique. A mon avis, cela participe au caractère assez typique de mes fromages, c’est sûr. On essaye de faire attention à l’alimentation, au bien-être pour les chèvres et tout. Ce serait dommage d’aller mettre une poudre qui uniformise nos produits.
La transmissions des savoirs et du savoir-faire
Si les valeurs guident la pratique de Géraldine, sa ferme n’est pas un isola. Dans l’exercice complet de son métier, l’éleveuse-fromagère a tissé un large réseau construit au fil des ans en accueillant des stagiaires et des Wooffeurs. Cette aide précieuse est également l’occasion pour l’éleveuse de transmettre son métier. Elle partage ses valeurs tout en montrant les gestes de la traite ou du tranchage du caillé à une stagiaire. Cette façon d’être avec les animaux, avec le milieu, avec les praticiens accompagnent l’apprentissage.
Aux visiteurs de la chèvrerie ouverte sur réservation, j’explique que la chèvre en Belgique ne reste pas dans un arbre et est dehors tout le temps, avance Géraldine. Par les quelques questions posées, l’éleveuse constate que « les gens » peuvent être déconnectés de ce qui est derrière le produit. Echanger, montrer, inviter à voir permet d’expliquer et de comprendre le système, ses composantes et les valeurs qui le forment. Les grands-parents qui viennent ont eux-mêmes aussi les étoiles dans les yeux de proposer un truc un peu moins ordinaire à leurs petits-enfants. Et donc tout ça pour moi, c'est vraiment important. Je prends le temps.
Géraldine prend le temps d’expliquer l’impact d’un retard pour visiter la chèvrerie parce qu’elle doit enchaîner avec la fabrique du fromage et la vente. Cela justifie le respect d’un horaire que le paiement de la visite ne rend pas caduque. Redorer l’image de l’agriculture et donner envie aux jeunes est un objectif supplémentaire du temps investi dans la communication.
Un avenir incertain : des doutes moteurs de solutions
On a deux hectares. Cela fait 14 ans que l’on cherche du terrain sans trouver et là le prix … C’est le même gars qui achète tout. Il n’y a aucune régulation et les terres agricoles partent en lotissement.
Si la transmission des savoirs est possible, la transmissibilité de la chèvrerie apparait actuellement irréalisable pour l’éleveuse. Le problème d’accès à la terre est un frein majeur à cette transmission. Dès lors, Géraldine déploie des trésors de créativité pour rebondir … et lutter. Avec des voisins, elle alerte les élus locaux sur l’avenir des terres agricoles publiques. L’intérêt du circuit court par-delà le produit est d’être directement concerné par des problématiques territoriales et des politiques de développement rural communes. Le réseau d’interconnaissances peut ainsi peser dans les décisions et on peut militer chez soi par l’éducation permanente évoquée plus haut.
Je m’intéresse à tous ces terrains qui n’intéressent pas les autres : lieux accidentés, envahis de pruneliers ou de ronces. Ils sont une plus-value pour les chèvres. Les chèvres accèdent à une belle biodiversité, mes ruminants sont des brouteurs- cueilleurs. C’est chronophage mais chouette.
Pour faire face au non-accès à la terre, Géraldine endosse certaines contraintes et emmène ses chèvres en balade le long de forêts, leur donnant accès à des plantes aux vertus médicinales. Par ailleurs, en développant des contacts et des partenariats, l’éleveuse permet à ses chèvres de pratiquer l’éco-pâturage des réserves naturelles Natagora. Ce qui implique de devoir régulièrement apporter de l’eau aux chèvres, et donc de faire plus de trajets pour aller voir ses animaux. Mais ce système lui permet aussi d’éleveur ses jeunes chevreaux, et de garder ses « grands-mères pensionnées » c’est-à-dire ses chèvres réformées.
On peut avoir l’impression que c’est un jeu mais je suis comme cela. Le monde est assez gris et même si je me pose de grosses questions, je reste super positive. Être négatif ne sert à rien explique l’éleveuse. Cependant, il y a un revers de la médaille : une remise en question permanente. Certes, cela permet à Géraldine d’avancer, de proposer, d’enrichir sa gamme, d’expérimenter mais elle est sans cesse en alerte, en questionnement et doute.
Avec du terrain autour, je verrais ma ferme collective et pas du tout seule. Je trouve qu'être seul sur une structure, c'est has been.
Géraldine a également songé à une ferme collective. Ne pas être seule est une sorte d’idéal ; non qu’elle soit isolée mais que des complémentarités et des synergies pourraient alléger la pénibilité des tâches, l’intensité de la cadence, les doutes tout en permettant l’absence.
De tels modèles atténueraient probablement une forte source de stress des producteurs liée à l’incapacité de travail. En effet, en raison de l’agilité nécessaire pour être active « De A à Z » dans toutes les étapes de production, trouver un remplaçant relève souvent de l’impossible.
C’est aussi, selon elle, un moyen de faire évoluer le métier et de s’ouvrir à l’extérieur du monde agricole. Il faudrait que ce soit beaucoup plus global, que ça regroupe les légumes, le pain, même je ne sais pas moi... Et que chacun soit polyvalent et justement pour pouvoir faire des week-ends hard où tu remplaces tous les trucs mais des week-ends trop cool. Enfin voilà, je trouve que ce métier doit évoluer comme ça aussi. Quelle que soit la forme d'agriculture qu'on a choisie, je pense que c'est commun à toutes les exploitations. Être seul, c'est seul.
Géraldine imagine alors un « service paysan » assuré par des personnes non installées, soit par choix soit par dépit. Elle envisage elle-même de devenir « volante » si sa chèvrerie devait fermer. Quand je réfléchis à l’éventualité d’arrêter, je me dis que je pourrais mettre en place un réseau de remplacement paysan avec élevage, transformation. On pourrait déployer des cellules d’intervention remplacement pour aider les malades ou juste respirer pour ne pas tomber malade.
Ce service paysan permettrait de voyager de ferme en ferme et ramènerait ainsi une forme de nomadisme, temporairement perdu mais tant apprécié par Géraldine.